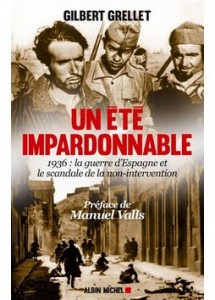
GRELLET, Gilbert, Un été impardonnable.1936 : la guerre d’Espagne et le scandale de la non-intervention. Préface de Manuel Valls. Paris : Albin Michel, 2016, 278 p.
La non-intervention en Espagne fut une des farces diplomatiques les plus scandaleuses perpétrées en Europe entre les deux guerres.
William Shirer, journaliste et historien américain.
Les démocraties occidentales ont abandonné à son sort la démocratie espagnole. La farce de la non-intervention a poignardé dans le dos un gouvernement démocratique constitutionnel sous le couvert de l’impartialité.
Claude Bowers, ambassadeur des Etats-Unis en Espagne.
Il eût suffi d’une aide insignifiante au gouvernement de Madrid pour qu’il étouffât dans l’œuf la rébellion.
Jean Zay, ministre de l’Education Nationale.
A l’été 1936, les troupes nationalistes du général Franco, avec l’appui d’avions allemands et italiens, remontent du sud de l’Espagne vers Madrid. C’est une véritable « colonne de la mort » (*), formée de légionnaires et de mercenaires marocains. En chemin, ils multiplient les massacres de civils et assassinent les responsables politiques d’une République espagnole fragile, qui avait appelé au secours le gouvernement français du Front populaire.
Indifférentes à ces crimes de masse, la France de Léon Blum, l’Angleterre de Churchill (**) et l’Amérique de Roosevelt ont refusé d’intervenir pour aider les démocrates espagnoles, alors que les régimes fascistes prenaient fait et cause pour Franco et les militaires putschistes.
Le livre de Gilbert Grellet est le récit de cette faute impardonnable, qui allait meurtrir le peuple espagnol et accroître l’appétit de conquête d’Hitler et de Mussolini, préfigurant Munich et la Seconde Guerre mondiale. A l’heure où se repose la question des interventions extérieures, cette leçon d’histoire sonne comme un avertissement. L’attentisme et la démission sont inexcusables dans les situations extrêmes.
Gilbert Grellet est écrivain et journaliste à l’Agence France-Presse, dont il a notamment dirigé le bureau de Madrid de 2005 à 2010.
[reproduction de la quatrième de couverture]
(*) Expression attribuée à l’historien Francisco Espinosa Maestre (membre par ailleurs du groupe d’experts chargés de la recherche et de l’identification des fosses communes).
(**) Stanley Baldwin est alors premier ministre.
Divisé en une quarantaine de courts chapitres, telle une chronique, ce récit est une reconstitution historique des premiers mois de la guerre civile en Espagne. Bien documenté, il a pour source livres et documents publiés sur la guerre d’Espagne et sur les principaux acteurs mais aussi journaux publiés à cette époque en Espagne, en France ou en Angleterre (voir bibliographie). Sont situés dans leur contexte les discours prononcés et les articles écrits par les grands protagonistes de ce drame (Blum, Churchill et Franco en particulier), enfin sont consultées les archives militaires allemandes de Fribourg et de l’Association pour la Récupération de la Mémoire Historique (ARMH) à Madrid. Les dialogues des réunions et les entretiens reconstitués dans l’ouvrage sont tirés directement de ces documents. Lise London (rencontrée par l’auteur en 2006 et décédée en 2012), participant à la création des Brigades Internationales, qui fut la secrétaire – interprète d’André Marty, capitaine dans la Résistance, qui a survécu aux camps de la mort nazis (comme son mari, le communiste tchèque Arthur London, auteur de l’Aveu) est l’inspiratrice de ce livre.
Lise London née Elisabeth Ricol, de parents espagnols :
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/1358528683.pdf
17 juillet 1936, soulèvement de la garnison de Melilla au Maroc espagnol.
Franco, surnommé « Miss Iles Canaries 1936» à cause de ses hésitations et sa façon de se faire désirer (les sobriquets concernant Franco sont nombreux et bien imagés), atterrit à Ceuta et rejoint le mouvement insurrectionnel initié par les généraux Mola (véritable cerveau et organisateur du soulèvement militaire), Sanjurjo (considéré comme le chef des insurgés). Queipo de Llano les a rejoints plus tardivement.
Dans cette colonne (la guerre dite « des colonnes » qu’elles soient franquistes ou républicaines – du POUM et de la CNT-FAI – se déroule au début du putsch, de juillet à novembre 1936) qui avance inexorablement vers la capitale, figurent les « volontaires » marocains tant redoutés. Souvent enrôlés de force, ils sont recrutés notamment par Soliman Al-Khattabi, un cousin d’Abd El Krim (chef de la révolte marocaine lors de la guerre du Rif dont la reddition aux espagnols ne sera effective qu’en 1926 grâce à l’appui déterminant des forces françaises commandées par Lyautey puis Pétain). Ces combattants, âgés de 16 à 50 ans, reçoivent une solde de 180 pts par mois (*), leurs parents reçoivent quant à eux huile, sucre, pain. Parfois, le butin recueilli, des machines à coudre Singer – très recherchées – sont directement expédiées par leurs officiers dans les douars du Rif oriental où s’effectue le recrutement nationaliste.
(*) 6 pts / jour est bon salaire pour un journalier agricole. En 1936, la majorité des articles de consommation courante était inférieur à 5pts : 1kg de pain ou de lait coûtait 70cts, pommes de terre 30cts, huile 2pts.
20 juillet.
José Giral, chef du gouvernement espagnol, envoie à son homologue français Léon Blum le message suivant : « Surpris par dangereux coup d’état militaire. Vous demandons de nous aider immédiatement par armes et avions. Fraternellement vôtre. Giral. »
Entouré de ses ministres, il n’y a aucun doute dans l’esprit de Léon Blum lors de cette réunion d’urgence à Matignon : « Bien entendu, nous allons accéder à leur demande. Le Frente Popular espagnol est dans le pétrin et nous devons absolument les soutenir. Vous êtes tous d’accord, n’est-ce pas ? ». Blum est en effet profondément solidaire des républicains espagnols.
23 juillet.
Stanley Baldwin (cousin de Rudyard Kipling), premier ministre conservateur (tory) de 1935 à 1937, laisse entendre à son homologue français quelques remarques préoccupantes : « Ne comptez pas sur nous. Londres resterait ‘ neutre ‘ si la livraison d’armes à Madrid entrainait un conflit avec Berlin ou Rome ». Il est clairement établi que les britanniques sont favorables aux militaires espagnols insurgés et pas seulement pour défendre les intérêts des entreprises britanniques actives en Espagne comme le groupe minier Río Tinto.
D’autre part, Franco s’est rendu des Canaries au Maroc en compagnie de l’ex- agent secret Hugh Pollard, dans l’avion Dragon Rapide loué en Angleterre à la compagnie Olley Air Services par le journaliste espagnol de droite Luis Bolín. Les militaires anglais à Gibraltar ont ensuite aidé en sous-main les rebelles en facilitant leurs communications téléphoniques. Neutralité ? Les dés sont pipés dès le début du conflit.
Les dirigeants britanniques ont été largement intoxiqués par les rapports des services secrets, le MI6, obsédés par la lutte contre le communisme, sur une soi-disant menace marxiste – en fait inexistante – dans la péninsule ibérique.
Une campagne de presse française de droite se fait l’écho de ces rumeurs.
Via « La revue de Paris » ou « La revue des deux mondes » l’homme politique et écrivain Jacques Bardoux (grand-père de Valéry Giscard d’Estaing) propage depuis plusieurs mois la fable d’un complot communiste pour justifier le putsch.
Voir également : BARDOUX Jacques, Le chaos espagnol, éviterons-nous la contagion ? Paris : Flammarion, 1937, 47p.
« Le juif Léon Blum nous conduira-t-il à la guerre ? » s’interroge ainsi L’Action française de Charles Maurras.
Blum autorisera en secret la livraison de quelques avions en pièces détachées ainsi que du matériel mais ces fournitures (payées en or) seront très limitées et insuffisantes.
Que faire ?
Albert Lebrun, esprit conservateur, président de la République, confie grandiloquent, à Blum : « Livrer des armes à l’Espagne peut signifier la guerre en Europe et la révolution en France. » Blum, isolé politiquement par son propre gouvernement et subissant la pression britannique, hésite à donner sa démission. Ses amis espagnols l’en dissuade car il est un précieux allié même si ses pouvoirs sont dérisoires. Blum, résigné, se voit contraint, à contrecœur, de se soumettre. Le gouvernement français décide alors à l’unanimité de n’intervenir en aucune manière dans le conflit intérieur espagnol et propose le principe de « non-intervention ».
Parmi les opposants les plus résolus à la non-intervention – nous devons les citer pour mémoire et par gratitude – figurent les socialistes Vincent Auriol (ministre des Finances, sera président de la République de 1947 à 1954), Roger Salengro (ministre de l’Intérieur), Georges Monnet (ministre de l’Agriculture), Marius Moutet (ministre des Colonies), Marx Dormoy (sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil) ou Léo Lagrange (sous-secrétaire d’Etat aux Loisirs et aux Sports, il soutint les Olympiades de Barcelone), mais aussi les radicaux Pierre Cot (ministre de l’Air), Maurice Viollette (ministre d’Etat), Jean Zay (ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts) ou Alphonse Gasnier-Duparc (ministre de la Marine).
En face, ceux qui soutiennent le projet d’abandonner à son sort la démocratie espagnole en arrêtant de lui vendre des armes ont un poids politique plus important, que ce soit parmi les radicaux, Camille Chautemps (ministre d’Etat, fut maire de Tours, député, il succéda à Blum en juin 1937), Edouard Daladier (ministre de la Défense nationale et de la Guerre), Yvon Delbos (ministre des Affaires étrangères), ou chez les socialistes, Charles Spinasse (ministre de l’Economie nationale), Albert Rivière (ministre des Pensions), Albert Bedouce (ministre des Travaux publics), Robert Jardillier (ministre des Postes, Télégraphes, Téléphones), ou encore Paul Faure (co-secrétaire général de la SFIO avec Léon Blum), chantre du pacifisme, qui finira rallié à Vichy en 1940 comme la plupart des personnages précités. A cette liste non exhaustive, il faut ajouter le très influent poète-diplomate Alexis Léger (remarqué depuis 1924 sous le pseudonyme de Saint John Perse, auteur du sibyllin recueil de poèmes Anabase, qui recevra le prix Nobel de littérature en 1960), secrétaire général du Quai d’Orsay qui saura convaincre le gouvernement Blum : « Il est indispensable d’éviter toute provocation, si nous intervenons pour aider le gouvernement Giral face aux putschistes, ce sera un chiffon rouge agité devant Berlin et Rome. »
Churchill, écarté du pouvoir depuis plusieurs années, ne joue aucun rôle décisionnel. Il occupe un siège aux Communes mais ses idées, ses suggestions, sont écoutées par les dirigeants anglais. Il est aveuglé par un anticommunisme virulent qui l’empêche d’apprécier objectivement la situation en Espagne.
Début août, la presse française fait état de livraisons à Franco d’avions italiens. Hitler envoie discrètement 52 avions sans plaques de nationalité et du matériel de guerre.
Un mois de conflit déjà. Lorca est assassiné le 18 août (une hypothèse communément admise est que José Valdés Guzmán, gouverneur civil de Grenade, aurait ordonné la mise à mort du poète après avoir reçu le feu vert de Queipo de Llano).
Début septembre, Irun tombe, premier genou à terre de la République.
Des meetings de soutien à la République espagnole sont organisés partout en France, « neutralité immorale » dénonce Le Populaire, organe du parti socialiste.
Le 9 septembre enfin a lieu à Londres la première réunion pour formaliser le pacte de non-intervention proposé par la France afin de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler les agissements des pays signataires. Vingt-cinq pays sont représentés hormis le Portugal et la Suisse. Dino Grandi, fasciste notoire représente l’Italie, Joachim Von Ribbentrop (futur ministre des Affaires étrangères), l’Allemagne. Cinq jours plus tard, un sous-comité est mis en place, composé de huit pays : Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Union Soviétique, Suède, Belgique et Tchécoslovaquie – ces trois derniers n’y feront que de la figuration. Dès le lendemain, Madrid fait savoir qu’il y a eu des violations de l’accord de la part de l’Allemagne, de l’Italie et du Portugal, en vain. L’opération « Feu magique », montée en une semaine, est le nom donné par Goering à l’aide militaire nazie aux nationalistes (en référence à l’opéra de Wagner « Siegfried »). Le 25 septembre, Julio Álvarez del Vayo, le ministre espagnol des Affaires étrangères, dénonce, indigné et impuissant, devant la 17è assemblée générale de la Société des Nations à Genève, ce scandale politique sans précédent. Rappelons que l’Allemagne n’est plus membre de la SDN depuis 1933.
Cette attitude va pousser Moscou à aider à son tour les républicains à partir du mois d’octobre. Ce « comité de non-intervention », comme il sera désormais désigné, va demeurer actif jusqu’en août 1938, et sera seulement dissous en avril 1939. Cynisme et hypocrisie.
Quelle est la position des Etats-Unis ?
Claude Bowers (*), ambassadeur des Etats-Unis en Espagne, véritable démocrate, considère que ce conflit oppose « une armée à un peuple », il dénonce « la sinistre farce et les simulacres éhontés» de la non-intervention, l’attitude « pitoyable » de Blum, la « trahison de la démocratie espagnole ». Roosevelt, initialement favorable aux républicains espagnols a cédé au secrétaire d’Etat Cordell Hull qui s’appuyait sur le Neutrality Act de 1935 (lois de neutralité et de non-interventionnisme dans les conflits étrangers) pour écarter toute idée de soutiens aux belligérants. Un embargo formel sera même décrété début 1937 alors que le Neutrality Act ne s’applique nullement aux guerres civiles comme le conflit espagnol. Comme pour la Grande-Bretagne, cette apparente neutralité penche plutôt du côté des insurgés car les milieux d’affaires américains accordent leur soutien aux putschistes. Texaco livre pétrole et carburant, Studebaker et Général Motors fournissent à crédit quelque douze mille camions, Dow Chemical livre des dizaines de milliers de bombes via l’Allemagne. En revanche, le 10 août, le gouvernement américain interdit au fabricant aéronautique Glenn L. Martin de vendre huit bombardiers à Madrid. Cependant, la grande majorité des journalistes américains couvrant le conflit espagnol appuie plutôt les républicains, Hemingway est le plus connu. Sur une idée de Maurice Thorez, le Komintern crée début novembre les Brigades Internationales, près de trois mille américains intégreront le bataillon Abraham Lincoln (aux côtés des dix mille français).
(*) BOWERS Claude G., Ma mission en Espagne 1933-1939. Paris : Flammarion, 1956, 412 p.
Le pacte de non-intervention ne sera pas respecté par les alliés de Franco. Entre avril et juillet 1937, 42 navires chargés de matériel de guerre à destination des franquistes passeront outre le blocus ou seront protégés par les « navires de contrôle » allemands et italiens. Malgré ces infractions, aucune mesure ne sera prise. En octobre 1937 ont lieu des premiers contacts entre la junte de Burgos et le gouvernement britannique. Des accords commerciaux sont signés et, le 16 novembre, les britanniques envoient Robert Hodgson comme « agent commercial ». Euphémisme pour un ambassadeur en puissance.
Abandonnée par les démocraties européennes, attaquée par les nazis et les fascistes, Franco a fait massacrer son peuple par des troupes étrangères. La République espagnole se vide de son sang.
Le 20 octobre 1936, Sanjurjo meurt dans un accident d’avion, le 3 juin 1937 c’est le tour de Mola dans les mêmes circonstances (Manuel Machado, frère d’Antonio, lui dédiera même un poème : « ¡ Emilio Mola ! ¡Presente ! »). Affranchi de ses principaux rivaux Franco a désormais le champ libre.
Nous connaissons la suite.
Ce livre nous place dans le fébrile contexte international et diplomatique qui règne au début du coup d’état militaire des insurgés contre la République. La boucherie de la Première Guerre mondiale a laissé des stigmates indélébiles aux victimes, mutilés, veuves, plaies restées ouvertes pendant encore plusieurs décennies pour cette génération née à la charnière des deux siècles : « plus jamais ça » répétaient-ils. La crainte d’un nouveau conflit mondial a probablement abusé non-interventionnistes et pacifistes face à une réalité qui leur échappait : « Il ne suffit pas d’interdire la guerre pour garantir la paix ». Dès 1933, quand Hitler devient chancelier, on relève dans la presse française les premières inquiétudes – justifiées – face à la lente montée de la peste brune. L’attentisme a rendu la guerre inexorable, déclenchée six mois après la fin de la Guerre Civile espagnole. On peut penser que les pays fascistes n’auraient pas résistés à une attitude ferme et non équivoque des pays démocratiques.


