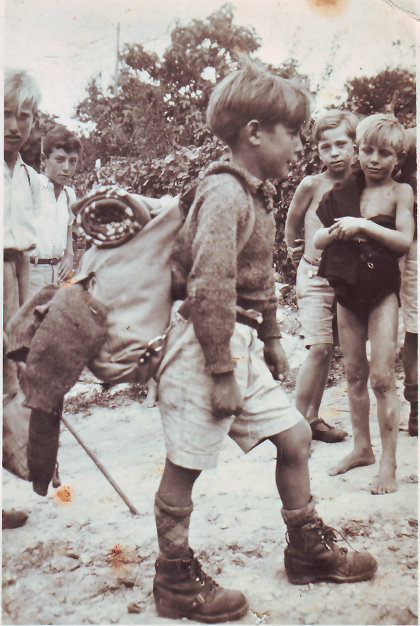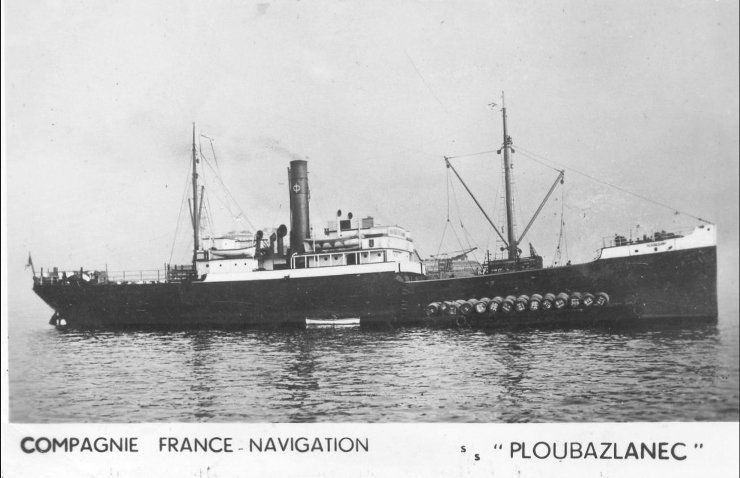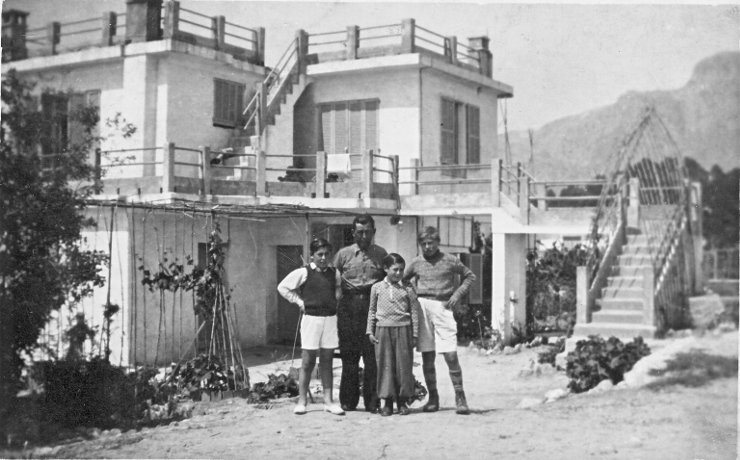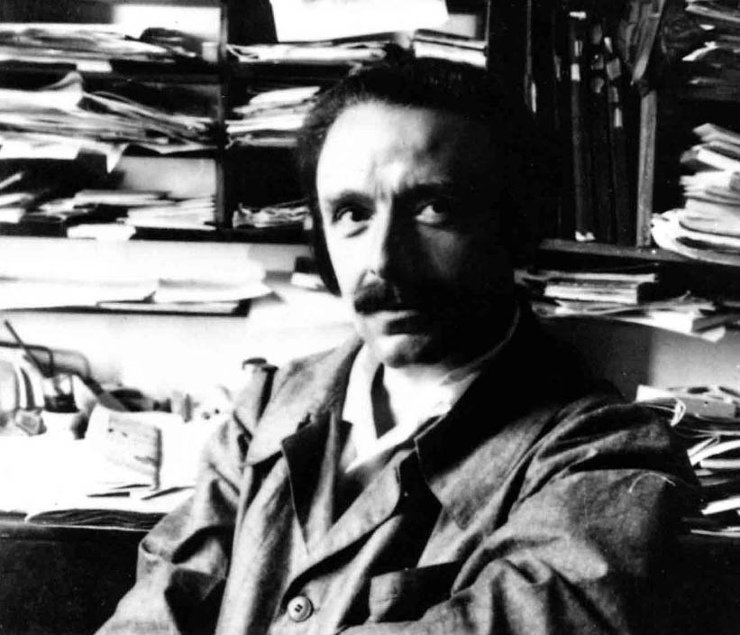Évelyne RIBERT (1), Bruno TUR (2)
CNRS, Centre Edgar Morin, équipe de l’IIAC
CRIIA, Université Paris Ouest Nanterre
RÉSUMÉ
Après avoir présenté les droits espagnol et français de la nationalité, cet article, basé sur des entretiens semi-directifs, analyse les choix des descendants des exilés politiques et des immigrés économiques espagnols, en France, en matière de nationalité. Les descendants des immigrés économiques sont généralement nés espagnols et ont pu ensuite devenir français, alors que les descendants d’exilés, généralement français, ont pu recouvrer ou acquérir la nationalité espagnole suite à l’adoption en Espagne, en 2007, de la « loi sur la mémoire historique ». Il ressort de cette recherche que les motivations et la signification liée à la possession de l’une ou l’autre nationalité diffèrent entre les deux groupes. Si les descendants des immigrés économiques choisissent leur nationalité en partie en fonction du pays dans lequel ils souhaitent vivre, les motivations des descendants d’exilés sont essentiellement symboliques.
RESUMEN
Tras presentar el derecho español y francés sobre la nacionalidad y basándose en entrevistas semidirigidas, este trabajo analiza la elección de nacionalidad de los descendientes de los exiliados políticos y de los inmigrantes económicos españoles en Francia. Los descendientes de los inmigrantes económicos nacen generalmente españoles, convirtiéndose posteriormente en franceses. Sin embargo, los descendientes de los exiliados políticos, generalmente franceses, pudieron recuperar o adquirir la nacionalidad española a partir de 2007 gracias a la «ley de memoria histórica». Nuestras investigaciones han puesto de realce las diferentes motivaciones y el significado que constituye poseer una u otra nacionalidad según los grupos estudiados. Si los descendientes de los inmigrantes económicos eligen, en parte, su nacionalidad en función del país donde desean residir, los motivos de los descendientes de los exiliados son esencialmente simbólicos.
En adoptant la « loi sur la mémoire historique »(3) en 2007, le parlement espagnol a permis aux descendants des exilés d’acquérir la nationalité espagnole que leurs parents ou grands-parents possédaient lorsqu’ils ont quitté l’Espagne, qu’ils l’aient conservée ou non par la suite. En fuyant leur pays à cause de la guerre civile et de la dictature franquiste, bon nombre des exilés se sont installés en France (4). Plus tard, pendant les Trente glorieuses, ils ont été rejoints par des migrants économiques qui, s’ils ne quittaient pas l’Espagne pour des raisons politiques, venaient chercher en France du travail et de meilleurs salaires (5).
Selon les cas et les époques, les descendants des exilés et des immigrés ont pu détenir, obtenir, perdre ou récupérer les nationalités française et espagnole, dans les conditions que nous allons exposer. L’objectif de notre article est non pas de proposer une étude quantitative de cette question, mais de procéder à une analyse des choix faits par les descendants en matière de nationalité, essentiellement à partir d’entretiens, en montrant les motivations des descendants des immigrés économiques et celles des descendants des exilés politiques. Que signifie, pour les uns et pour les autres, la possession de la nationalité française et de la nationalité espagnole ? Quelles logiques président à leur choix ? Celles-ci sont-elles analogues ou s’avèrent-elles différentes ?
Après avoir présenté les droits espagnol et français de la nationalité, qui déterminent le cadre juridique dans lequel les choix s’effectuent, nous analyserons les décisions prises par les descendants d’immigrés économiques et d’exilés politiques en matière de nationalité.
L’évolution du droit de la nationalité espagnole
La loi espagnole en matière de nationalité privilégiant le jus sanguinis plutôt que le jus soli, les enfants des ressortissants espagnols sont espagnols dès leur naissance, qu’elle ait eu lieu en France ou ailleurs et quelle que soit la période (6). Plus tard, ceux d’entre eux qui sont devenus français possédaient donc déjà la nationalité espagnole au moment de cette acquisition. Si la possession d’une autre nationalité lorsqu’on devient français ne pose pas de problème à l’administration française, en revanche, jusqu’à aujourd’hui encore, la loi espagnole est plus restrictive pour ses ressortissants qui acquièrent une autre nationalité.
En effet, l’Etat espagnol ne permet pas à ses ressortissants d’acquérir une autre nationalité : ceux-ci peuvent perdre leur nationalité espagnole. Du fait de l’importance de l’émigration espagnole transocéanique, l’Espagne a signé divers accords de double nationalité entre 1958 et 1980 qui ne concernent que des pays d’Amérique du Sud (7). Si la Constitution de 1978 réaffirme la possibilité pour l’Etat espagnol d’établir « des traités de double nationalité avec les pays ibéro-américains ou avec ceux qui ont ou qui ont eu un lien particulier avec l’Espagne »(8), aucun accord n’a été signé avec un pays européen, bien que le flux migratoire espagnol se soit essentiellement orienté, dès les années 1950, vers des pays comme la France, l’Allemagne ou la Suisse.
Dans ce contexte, deux remarques importantes doivent être soulevées. La première, c’est que l’acquisition de la nationalité française pouvait et peut entraîner, pour les descendants des exilés et immigrés qui sont nés espagnols, la perte de leur nationalité espagnole d’origine, dans les conditions que nous allons voir. Aussi, en l’absence d’accord de double nationalité entre l’Espagne et la France, il faut donc parler de binationalité plutôt que de double nationalité pour les ressortissants franco-espagnols, car les Espagnols d’origine qui sont devenus ou qui souhaitent devenir français ne bénéficient pas des droits garantis par les accords de double nationalité (9).
Bien que la Constitution espagnole précise qu’ « aucun Espagnol d’origine ne pourra être privé de sa nationalité »(10), la loi prévoit la perte dite volontaire de la nationalité espagnole (11) pour trois motifs : l’acquisition d’une autre nationalité (12) ; l’usage exclusif d’une autre nationalité acquise avant la majorité (13) ; le renoncement à la nationalité espagnole (14).
Ainsi, sous le franquisme comme depuis le retour de la démocratie en Espagne, l’acquisition de la nationalité française peut amener le binational franco-espagnol à perdre sa nationalité d’origine, ce que des associations dénoncent sans que l’Etat espagnol ne règle ce problème. Les binationaux doivent donc, à un moment donné, « manifester leur volonté de demeurer espagnols » et « faire usage de cette nationalité », ce que l’on peut traduire par tenir ses papiers d’identité à jour, faire usage d’un passeport espagnol ou exercer son droit de vote, sans toutefois disposer d’éléments clairs sur cette notion d’usage. Ils s’exposent sinon à une perte de leur nationalité d’origine, malgré ce que dit la Constitution espagnole. Ce flou législatif amène les consulats, comme celui de Paris, à exiger parfois des Franco-espagnols qui souhaitent renouveler leur passeport qu’ils produisent une déclaration écrite stipulant qu’ils renoncent à la nationalité française (15) !
En Espagne, la question de la nationalité des descendants d’Espagnols à l’étranger a été très présente dans le débat public ces dernières années. Mais ce débat concernait plus particulièrement les descendants des exilés, puisqu’il a été amené par le vote des « lois mémorielles » au Parlement. Comme Franco demeurait au pouvoir et que la restauration de la démocratie paraissait de plus en plus improbable, certains exilés, qui avaient conservé leur nationalité espagnole dans l’espoir d’un retour en Espagne, se sont naturalisés lorsqu’ils ont compris qu’ils ne quitteraient pas de sitôt leur pays d’accueil (16). Ils ont donc pu perdre leur nationalité espagnole lorsqu’ils ont pris la nationalité de leur pays de résidence ou, dans le cas des femmes, lorsqu’elles ont épousé un ressortissant français ou étranger. Par ailleurs, d’autres exilés ont pu être privés de leur nationalité par l’Etat franquiste pour cause de déportation (17).
Si la première de ces lois (2005) accordait une pension aux « enfants de la guerre » –c’est-à-dire aux enfants espagnols que les républicains avaient évacués à l’étranger (en Europe et en Amérique du Sud), où beaucoup étaient restés – sans aborder la question de leur nationalité (18), la loi suivante (2006), qui concernait le statut des Espagnols (quel que soit le motif du départ) résidants à l’étranger, annonçait une réforme de la nationalité « dans les six mois »(19) qui, pour les descendants des immigrés, se fait encore attendre. Mais c’est surtout le texte connu sous le nom de Loi de la mémoire historique (20)
(2007) sur les victimes de la guerre civile espagnole et de la dictature qui intéresse le droit de la nationalité espagnole, puisqu’il reconnaît aux descendants des exilés – ces exilés qui ont été espagnols d’origine – la possibilité de récupérer ou d’acquérir, selon les cas, la nationalité espagnole (21). Concrètement, les enfants dont l’un des deux parents était espagnol d’origine, ainsi que leurs petits-enfants (22), pouvaient acquérir la nationalité espagnole, si l’ascendant exilé avait quitté l’Espagne entre le 18 juillet 1936 (début de la Guerre civile) et le 31 décembre 1955 (23). Pour faire valoir ce droit, les descendants ont pu déposer leur dossier de demande d’acquisition de la nationalité espagnole entre le 29 décembre 2008 et le 27 décembre 2011.
L’évolution du droit de la nationalité française
En France, le code de la nationalité se fonde, depuis plusieurs siècles, sur une combinaison du droit du sang et du droit du sol. Ainsi, l’enfant né d’au moins un parent français est français de naissance, y compris s’il est né à l’étranger (jus sanguinis), tout comme l’enfant né en France d’au moins un parent qui y est lui-même né, quelle que soit la nationalité de celui-ci (jus soli). Toujours en vertu du droit du sol, l’enfant né en France de parents étrangers devient français de plein droit à sa majorité s’il remplit certaines conditions de résidence. La nationalité française peut également s’acquérir à raison du mariage et par naturalisation.
Depuis le début des années 1980, le droit de la nationalité française a connu un durcissement sous l’effet de la montée du Front national, dont certains des thèmes ont été repris par la droite. L’immigration a été présentée comme une menace pour l’identité nationale, notamment en raison de son origine extra-européenne. Les pouvoirs publics ont accrédité cette analyse (24). Différentes lois ont été adoptées qui visaient à rendre plus difficile l’accès à la nationalité française afin de lutter contre la fraude et de s’assurer de l’intégration et du partage des valeurs républicaines des candidats à la nationalité. « Ces mesures ont eu pour effet de conforter l’idée qu’un doute planerait sur l’intégration ou la volonté de s’intégrer [de ces derniers] »(25). La création d’un Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement par Nicolas Sarkozy en 2007 est venue encore conforter l’idée que l’immigration mettrait en péril l’identité nationale.
La première offensive, en 1986, a concerné le droit du sol, notamment l’obtention automatique de la nationalité française à 18 ans par les jeunes nés en France de parents étrangers, qu’il s’agissait de remplacer par une démarche volontaire à la majorité.
Précisons que si les jeunes acquéraient alors automatiquement la nationalité française, ils avaient la possibilité de la décliner dans l’année précédant leur majorité avec l’accord de leurs parents. Le présupposé sous-tendant cette proposition de réforme était que l’intégration des étrangers se ferait plus difficilement que par le passé et que dès lors la naissance et la résidence en France ne suffiraient plus à la garantir. Il faudrait y ajouter l’expression de la volonté. Il serait ainsi possible de s’assurer du désir des jeunes de devenir français et de raffermir leur sentiment d’appartenance à la France, en instituant un rite de passage (26). Après de longs débats et rebondissements, une réforme a été adoptée le 22 juillet 1993 (27). Alors que, depuis 1945, les jeunes nés en France de parents étrangers devenaient automatiquement français à la majorité, à condition d’habiter sur le territoire et d’y avoir résidé au cours des 5 dernières années et qu’en outre, leurs parents pouvaient réclamer pour eux à n’importe quel âge cette nationalité, moyennant une condition de résidence analogue, la loi Méhaignerie instaura une manifestation de volonté à effectuer entre 16 et 21 ans. Passés 18 ans, l’intéressé pouvait se voir refuser la nationalité française s’il avait fait l’objet de certaines condamnations. Avec le retour de la gauche au pouvoir en 1997, la loi fut abrogée. La loi Guigou du 16 mars 1998 (28), toujours en vigueur, rétablit l’obtention automatique de la nationalité française à la majorité, avec possibilité de décliner la nationalité française dans les 6 mois précédant la majorité et dans l’année qui suit, tout en assouplissant la condition de résidence.
L’intéressé doit désormais justifier d’une résidence « en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, depuis l’âge de 11 ans »(29). La nationalité française peut également être acquise par déclaration dès 13 ans avec l’autorisation des parents et à condition d’avoir résidé en France au cours des 5 dernières années. La possibilité de devenir français avant 13 ans n’a en revanche pas été rétablie. Rien ne peut enfin s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par l’enfant mineur, alors que des possibilités d’opposition existent en cas de condamnations pénales pour l’enfant majeur.
Dans les années 1993 et surtout 2000, ce sont les règles d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage et par naturalisation qui ont été peu à peu durcies, avec l’augmentation progressive du délai au bout duquel un étranger marié à un ressortissant français peut devenir français par déclaration, porté à 4 ans en 2006 (30), ainsi que l’introduction de conditions liées à la connaissance de la langue (31), de l’histoire et de la culture françaises (32). L’acquisition de la nationalité française a également été solennisée avec l’instauration de « cérémonies d’accueil »(33). Jusqu’en 1993, le conjoint étranger d’un ou d’une Française pouvait devenir français par déclaration 6 mois après le mariage, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le gouvernement ne s’y oppose pas pour indignité ou défaut d’assimilation (34). La loi du 9 janvier 1973 avait instauré l’égalité entre époux et épouse, alors qu’auparavant la femme étrangère se mariant avec un Français devenait automatiquement française, même si elle pouvait dans certains cas décliner cette nationalité, alors que l’époux étranger ne pouvait devenir français que par naturalisation. La naturalisation, attribuée de façon discrétionnaire par les pouvoirs publics, en fonction d’éventuels critères d’opportunité, pouvait quant à elle être demandée après 5 ans de résidence en France et était subordonnée à des conditions de bonnes vie et mœurs, ainsi qu’à l’assimilation de l’intéressé en France, notamment à une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Précisons enfin que la France autorise ses ressortissants à avoir la plurinationalité, mais ne la reconnaît pas, puisqu’elle ne considère que la qualité de Français de l’intéressé : un binational possédant la nationalité française est considéré par la France comme son ressortissant exclusif, quelle que soit son autre nationalité (35). Lorsqu’un Français acquiert une autre nationalité, la loi française n’exige pas qu’il renonce à sa nationalité française. Et lorsqu’un étranger devient français, il peut conserver sa nationalité d’origine.
Les descendants des immigrés et des exilés en France et le choix de la nationalité
Les descendants des immigrés économiques
La question du choix de la nationalité chez les descendants des immigrés économiques espagnols en France (36) est pour l’instant mieux connue que celle des rapports à la nationalité chez les descendants des exilés, grâce en partie à deux recherches que nous avons menées dans le passé et dont les conclusions ont été publiées (37). Si, pour l’étude comparative menée par Evelyne Ribert, seuls quelques descendants d’Espagnols avaient été rencontrés, principalement au milieu des années 1990, parmi ceux d’autres nationalités, la recherche dirigée par Laura Oso Casas portait spécifiquement sur les descendants des immigrés espagnols à Paris. Pour le rapport final, trente entretiens individuels approfondis (38) avaient été réalisés avec des personnes majeures, principalement à Paris, mais aussi en Espagne, entre mars et juin 2007, ainsi qu’un entretien de groupe avec des parents espagnols à Paris (39). Le livre paru est une version remaniée de ce rapport, remis au Ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales en 2007, à un moment où l’Espagne semblait redécouvrir son histoire migratoire (40). Les deux études ont permis de distinguer chez les descendants des immigrés trois groupes, aux projets de résidence différents, qu’il est important de présenter avant d’aborder la question du choix de la nationalité.
Le premier groupe est celui où les enfants s’identifient au pays des parents. Ceux qui le composent ont pour objectif de s’installer en Espagne. Le deuxième groupe comprend ceux qui rêvent d’un retour en Espagne, sans toutefois proposer un projet concret. Ils entretiennent avec l’Espagne une relation plutôt affective et sentimentale. Le troisième groupe est composé par ceux qui ont l’habitude de vivre en France et n’envisagent guère de s’installer en Espagne. L’appartenance à l’un ou l’autre de ces groupes n’implique donc pas les mêmes besoins administratifs. En dehors de cas exceptionnels, les personnes ayant participé aux entretiens ont pu choisir de posséder l’une ou l’autre des nationalités espagnole ou française, voire les deux, puisqu’il est possible, une fois la nationalité française acquise, de conserver sa nationalité espagnole si on manifeste cette volonté et si cette nationalité est utilisée.
Nous pourrions penser que le choix s’est fait en fonction de l’appartenance à l’un des trois groupes présentés ci-dessus et que, par exemple, ceux qui s’identifient au pays des parents n’ont que la nationalité espagnole. Pourtant, ce n’est pas le cas. En effet, chez ceux qui n’ont que la nationalité française, on trouve des personnes qui souhaitent également obtenir la nationalité espagnole. Au moment des entretiens, certains avaient d’ailleurs entamé des démarches administratives dans ce but. Néanmoins, la majorité de ceux qui n’ont que la nationalité française n’envisage absolument pas d’acquérir l’espagnole, non par rejet, mais parce qu’ils n’en voient pas l’utilité puisque leurs « papiers » français leur permettent d’aller et de venir entre la France et l’Espagne quand ils le souhaitent. Chez ceux qui n’ont que la nationalité espagnole, on observe trois cas de figure. D’abord, on trouve ceux qui sont retournés vivre en Espagne, avec leurs parents, lorsqu’ils étaient petits. Hormis une exception, ils ne sont plus revenus vivre en France et nous les avons interviewés en Espagne. Ils n’ont donc pas acquis automatiquement la nationalité française et n’ont pas pu manifester leur volonté de l’acquérir une fois majeurs, puisqu’ils ne résidaient plus en France. On trouve aussi ceux qui sont arrivés adolescents en France, avec leurs parents migrants, et qui n’ont pas fait les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité française par naturalisation. Enfin, il y a ceux qui ne se sentent pas français, bien qu’ils soient nés en France et qu’ils y vivent encore parfois. Ils utilisent leur carte d’identité espagnole (Documento nacional de identidad, DNI), ainsi qu’une carte de séjour française. Généralement, ils souhaitent s’installer en Espagne, comme le montre le témoignage de Teresa Gomez (41), qui y vit déjà, mais n’a quitté Paris qu’à 26 ans :
Pourquoi aurais-je voulu la nationalité française ? Moi, ce que je voulais, c’était retourner en Espagne, l’important, c’était d’avoir la nationalité espagnole. Mes parents ont évoqué la nationalité française, mais j’ai dit que je n’en voulais pas. J’avais déjà mon DNI et mon passeport espagnols, c’était suffisant. En France, j’utilisais la carte de séjour. Mais après, pour les Espagnols, ça n’était plus obligatoire de l’avoir.
Il est intéressant de noter que les descendants parlent de « retour » en Espagne, bien qu’ils n’y aient majoritairement jamais vécu. Ils ont en fait assimilé l’idée de retour véhiculée par les parents, une idée fondamentale pour la migration espagnole des années 1960, puisque l’émigration espagnole vers un pays européen devait théoriquement s’achever par un retour rapide. Les parents, bien qu’ils aient prolongé leur séjour à l’étranger, ont tout de même élevé leurs enfants en les préparant à cette idée du retour (42).
Enfin, le fait de posséder les deux nationalités ne résulte pas toujours d’une décision personnelle mûrement réfléchie. Certains sont espagnols de naissance et ont acquis la nationalité française avant leur majorité suite aux démarches administratives effectuées par leurs parents. D’autres souhaitent posséder les deux nationalités. Majoritairement, ces derniers vivent en France. Pour certains, la carte d’identité française est en cours de validité, mais les passeports ou DNI espagnols sont périmés. D’autres ont tous leurs papiers à jour car ils veulent utiliser leur carte française lorsqu’ils sont en France et leur DNI lorsqu’ils sont en Espagne. Le choix de prendre ou non la nationalité française peut répondre à des motivations purement stratégiques. Bien que vivant en France où il est né de parents espagnols, Jaime Muñoz explique qu’il n’a pas souhaité acquérir la nationalité française pour contourner l’obligation de service militaire. En effet, les hommes binationaux ont dû répondre aux obligations militaires, en France comme en Espagne, jusqu’à la professionnalisation des armées des deux pays respectivement en 1997 et en 2001. On peut remarquer que les binationaux qui ont choisi de faire leur service en Espagne avaient le projet de s’y installer. Mais la grande majorité de ceux qui ont dû faire leur service l’ont fait en France, avant tout pour des raisons pratiques puisqu’ils y résidaient. La loi espagnole prévoyait cette possibilité en considérant qu’un Espagnol résidant à l’étranger n’avait plus d’obligation de service militaire en Espagne s’il l’avait accompli dans un pays avec qui elle avait signé un accord, ce qui était le cas de la France (43). Les ressortissants espagnols résidant en France, qu’ils soient binationaux ou non, pouvaient demander des dérogations d’incorporation aux autorités militaires espagnoles, au motif qu’ils poursuivaient leurs études ou qu’ils ne résidaient pas en Espagne (44). En ne prenant pas la nationalité française, Jaime Muñoz n’était donc tenu de faire le service militaire qu’en Espagne. Mais comme il vivait en France, il pouvait demander des reports d’incorporation (45).
Les parents interviennent parfois pour que leurs enfants conservent la nationalité espagnole. Cette intervention n’est pas toujours motivée par l’identification au pays. Marta Ferrer, par exemple, a conseillé à son fils, de nationalité française, de prendre également la nationalité espagnole : « Si un jour il hérite de notre appartement en Espagne, s’il est espagnol, il ne paiera pas d’impôts de succession, contrairement a quelqu’un qui n’a qu’une nationalité étrangère »(46). Pour ceux qui vivent en France, la possession de la nationalité espagnole peut contenir une forte charge symbolique. Chez les binationaux, le fait d’utiliser les documents espagnol ou français a beaucoup à voir avec le regard de l’autre. Les entretiens montrent que, lorsqu’ils sont en séjour en Espagne, les insinuations sur le fait qu’ils sont plus français qu’espagnols les agacent, comme en témoigne Matthieu Vazquez :
En Espagne, je ne ressens pas le même besoin de dire que je suis français, mais en France j’ai besoin de dire que je suis espagnol… Tu vois ? De dire que c’est un orgueil d’être espagnol. En Espagne, je ne cache pas que je suis français, mais je ne le mets pas en avant. Là-bas, quand on me dit franchute, je sors mon passeport et je réponds «eh bien non, je suis espagnol comme toi !». Je sors mon passeport et je le montre.
Contrairement à Matthieu, Pere Teran a grandi en France, mais est rentré vivre en Espagne avec ses parents. S’il aimerait avoir un document d’identité français, c’est « pour les souvenirs, pour qu’on sache que je suis français, que j’y suis né ». Les deux exemples précédents montrent comment la matérialisation de la nationalité par le papier peut symboliser l’identification ou l’attachement à l’un des deux pays. Les cartes nationales et les passeports permettent de montrer que l’on est seulement ou également espagnol ou français, dans des contextes particuliers. Au-delà de la problématique politico-administrative de la nationalité, il faut donc noter que le fait d’être descendant d’immigrés espagnols en France implique ou a impliqué des questionnements sur l’identité personnelle de chacun, et plusieurs personnes rencontrées en 2007 le disent au cours des entretiens, principalement celles nées avant les années 1980. Les descendants se sont parfois sentis « coupés en deux » avant de choisir l’un ou l’autre pays, ou les deux. Mar Navarro, qui vit en France et qui est binationale, dit qu’elle a parfois « l’impression de se sentir étrangère en France (…). Je ne peux pas me sentir complètement française, parce qu’il y a mes origines espagnoles ». Cependant, une fois devenus adultes, beaucoup tranchent ces questions, comme Miguel Lopez : « Avec cette double culture, il y a toujours un moment où tu te demandes si tu es une chose ou l’autre. Avec le temps, je me suis dit que je suis l’une et l’autre ».
Pour les ressortissants espagnols ou binationaux vivant en France, les relations avec l’administration consulaire et l’ambassade d’Espagne sont rares et, parfois, inexistantes. Si la majorité des personnes interviewées a été, à un moment donné, inscrite au Registre civil consulaire, peu d’entre elles ont mis à jour cette inscription en signalant, par exemple, une nouvelle adresse. Si le passeport peut être délivré ou renouvelé tant en Espagne que dans les consulats espagnols, il n’en va pas de même pour le DNI, puisque les démarches pour l’obtenir doivent obligatoirement se faire en Espagne, ce que regrette Matthieu :
J’aurais aimé [avoir le DNI], mais c’est toute une gestion, au consulat d’abord (47), puis dans mon village en Espagne, ça me fatigue. Mais ça m’aurait aidé. […] Par exemple sur Internet, dans les forums… dans le forum de Marca (48), si tu veux laisser un message ils te demandent le numéro de DNI. Sans lui, tu ne peux pas. (…) Ce sont des petits détails, mais bon. Et [en Espagne], dès que tu as besoin d’un document, on te le demande. Je devrais le faire faire, mais c’est compliqué.
En ce qui concerne les pratiques électorales, nous savons que le taux d’inscription sur les listes électorales françaises des descendants d’Espagnols est plus élevé que pour les descendants d’autres nationalités de l’immigration (49), ce que les entretiens réalisés confirment. En revanche, les binationaux résidant en France ne votent pas toujours aux élections espagnoles, alors que ceux qui n’ont que la nationalité espagnole semblent plus impliqués. Les binationaux affirment qu’ils ne reçoivent aucune information des partis politiques espagnols. Lorsqu’ils votaient aux municipales avant que la loi soit modifiée, ils le faisaient parce que, disaient-ils, ils connaissaient les représentants politiques du village. Par contre, s’ils ne votent pas aux élections autonomiques ou nationales, c’est parce qu’ils ne sauraient pas à qui donner leur voix. On peut observer que ceux qui votent en France et en Espagne le font pour les mêmes courants d’idées. Aussi, les binationaux ne votent pas forcément deux fois, comme ils pourraient le faire, aux élections européennes, puisqu’ils se contentent de voter en France. Au-delà des réticences personnelles, il faut noter que la loi espagnole rend difficile l’exercice du vote à ses ressortissants vivant à l’étranger, d’une part parce qu’ils sont désormais exclus des municipales, d’autre part parce que la procédure pour voter aux autres élections depuis l’étranger est souvent lourde : les citoyens espagnols souhaitant voter doivent préalablement être inscrits au CERA (50), qui recense les Espagnols résidant à l’étranger ; ils doivent ensuite adresser au bureau électoral dont ils dépendent, par courrier et avant une certaine date, une demande d’autorisation de voter. Ils reçoivent ensuite les documents nécessaires pour exercer le droit de vote et peuvent ensuite voter soit au consulat, soit par courrier.
Les descendants des exilés politiques
Pour les descendants d’exilés, la décision, depuis la « loi sur la mémoire historique » de 2007, de recouvrer ou d’acquérir cette nationalité obéit à une logique partiellement différente. Il ne s’agit pas ici de faire une comparaison entre les deux populations, différentes à maints égards (âge, date d’arrivée de la famille en France, statut socioprofessionnel, etc.) mais simplement de mettre en regard la signification hétérogène conférée à l’appartenance nationale dans l’un et l’autre cas. D’après les informations fournies par le ministère espagnol des Affaires Etrangères et de la Coopération, 503.439 demandes auraient été déposées dans 183 bureaux consulaires, 94,84% (477.462) d’entre elles l’ayant été en Amérique du Sud. 92,34% des requérants sont des enfants de père et/ou mère espagnole d’origine et 6,32% des petits-enfants de personnes ayant perdu ou renoncé à leur nationalité espagnole.
Notre analyse de la signification de l’acquisition de la nationalité espagnole dans ce cas se fonde sur 16 entretiens approfondis réalisés avec des réfugiés et descendants de réfugiés, rencontrés par le biais d’une exposition « Portraits de migrations, un siècle d’immigration espagnole en France », présentée en octobre 2007 dans des locaux associatifs espagnols à Saint-Denis, en région parisienne, et à laquelle l’un des membres de leur famille s’était rendu. Au sein d’une même famille, différentes générations ont été interrogées. Au total, 20 personnes issues de l’exil, appartenant à 10 familles, ont été rencontrées en 2007 et 2008, au cours d’entretiens individuels ou à plusieurs : précisément un réfugié (51) ayant combattu pendant la Guerre civile, deux personnes arrivées enfants en France entre 1945 et 1950, quatre enfants nés en France d’au moins un réfugié ayant défendu la République, six enfants d’exilés qui étaient enfants pendant la Guerre civile (52), six petits-enfants d’au moins un grand-père combattant, enfin un petit-enfant dont les grands-parents sont arrivés enfants en France. L’enquête portait sur la transmission (ou l’absence de transmission) de l’histoire migratoire familiale au sein de la famille. Aucune question n’était posée sur l’éventuelle acquisition de la nationalité espagnole, mais 8 personnes en ont parlé spontanément. Deux d’entre elles avaient obtenu la nationalité espagnole une dizaine d’années auparavant, une venait de déposer une demande en ce sens et quatre autres s’interrogeaient ou s’étaient interrogées sur la décision à prendre. À partir des propos recueillis, et sans prétention aucune à l’exhaustivité, en raison du nombre réduit de personnes ayant évoqué cette question, il s’agit ici de mettre en évidence quelques-unes des logiques qui président à la demande d’acquisition de la nationalité espagnole de la part de descendants d’exilés nés en France et d’exilés. Dans presque tous les cas, la demande de nationalité espagnole répond à des raisons symboliques. Seule fait exception une dame arrivée enfant en France qui l’a acquise pour des raisons pratiques alors qu’elle était engagée dans la rénovation de la maison familiale en Espagne. On peut distinguer deux logiques. L’envie ou la décision de prendre la nationalité espagnole peuvent d’abord être liées, en particulier pour ceux qui sont nés en France, enfants et petits-enfants confondus, à un sentiment de perte ou à la recherche de l’histoire de leurs ascendants. Ce sentiment peut naître de l’impression de ne rien connaître du passé des parents ou grands-parents qui n’ont pas souhaité relater ce qu’ils avaient vécu et ont recherché avant tout l’intégration. Le cas d’Albert Uritziar, proche de la soixantaine, paraît assez exemplaire. Interrogé sur ce que ses parents et grands-parents lui ont raconté, il répond :
Très très peu de choses. (rires) Mes parents étaient assez jeunes pendant la Guerre d’Espagne. […] Mon grand-père maternel, qui était très impliqué, était anarchiste et maire de son village. En 39, il a quitté l’Espagne et est passé par Perpignan, comme la plupart des Espagnols, avec les camps de concentration […] et ma mère et ma grand-mère sont restées en Espagne. Elles sont venues, elles, après la Deuxième Guerre Mondiale en 47 et elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver mon grand-père qui ne voulait pas être retrouvé (rires) en clair. Ça, c’est une histoire qui a été cachée très très longtemps. En fait, ma mère ne m’avait jamais parlé de ça, absolument jamais et elle est morte très jeune […]. Ma grand-mère est morte dans la foulée, donc je n’en ai pas discuté avec elle et avec mon grand-père, c’était hors de question (rires). Mon père lui, il était très jeune pendant la guerre civile, il a participé un petit peu […] en portant des trucs aux combattants. Je ne sais pas trop. Il m’en a très peu parlé, ils en parlaient très peu entre eux de ce qu’ils ont fait. En fait, ils ont tiré un trait sur leur passé quand ils sont venus en France. Mon père est venu en 47-48, […] il était déserteur de l’armée espagnole. […]
Ils ont tiré un trait avec le passé, par le fait même que — nous étions trois enfants —ils ne nous ont jamais parlé en espagnol […]. Ils sont devenus français rapidement, ils ont voulu une intégration maximum […], donc l’usage de la langue, l’oubli du passé, enfin l’oubli, je ne pense pas qu’ils l’aient oublié mais ils n’en parlaient pas ou très rarement. […] Les problèmes avec mon grand-père — je suis le tout petit de la famille — j’ai su ça par mon frère aîné qui n’est plus.
Albert Uritziar, très ému au cours de l’entretien, regrette de ne pas mieux connaître le passé familial. En outre, plus personne ne peut le renseigner, ses parents étant décédés jeunes, son grand-père une douzaine d’années auparavant et son grand frère dernièrement. Il ne reste que la sœur de sa mère, qu’il n’a pas vue depuis l’enterrement de son grand-père et qui, née en 1939, ne pourra pas lui parler de la Guerre Civile. Albert Uritziar est « en train d’acquérir la nationalité espagnole » pour « retrouver [ses] racines » :
C’est comme ça, parce que je veux savoir aussi… C’est mes racines. Donc je veux retrouver un peu mes racines quand même. En même temps, j’ai fait quelques recherches généalogiques, essayé de retrouver le reste de ma famille… Du côté de ma mère, je ne connais absolument personne en Espagne, personne ! Du côté de mon père, j’ai connu un petit peu, parce que quand j’étais gamin, 12, 13 ans, nous sommes allés dans sa famille.
Pour Albert Uritziar, la décision de demander la nationalité espagnole semble liée à un sentiment de perte, qui paraît lui-même déclenché par le décès de son frère ainsi que par la visite de l’exposition sur l’immigration espagnole, à laquelle il a appris qu’il lui était possible de réclamer la nationalité espagnole. Peut-être un effet d’âge ou de cycle de vie joue-t-il également ? L’envie d’acquérir la nationalité espagnole semble procéder du même ressort chez Victor Hernandez, la vingtaine, petit-fils de Mario Hernandez, dont le père a été fusillé par les franquistes avant sa naissance et qui est arrivé avec sa mère en France en 1949 à l’âge de 10 ans. Il invoque, entre autres raisons :
Je me sens aussi un peu… de ce côté-là [espagnol] et pour moi, c’est très important de garder ce côté, d’autant plus que l’histoire familiale est assez… Pour moi, elle est importante et c’est des choses qui ne doivent pas se perdre, comme la mémoire de la shoah, de tout ça. […] J’ai envie de renouer justement, comme mon père a un peu pris ses distances avec ça. Il parle couramment espagnol, il y va quand même assez régulièrement, mais lui […], son but, c’était quand même plus, pas l’acculturation, mais il a vraiment essayé de s’intégrer le plus possible dans la société française. Et moi c’est vrai que, du coup, je repars un peu dans le mouvement inverse, je ne sais pas si c’est parce que j’ai toujours fait l’inverse de mon père.
Victor Hernandez, qui regrette de n’être pas bilingue, aimerait passer un an en Espagne et n’exclut pas un jour de s’y installer. Il évoque cette question de nationalité juste après avoir parlé de la vente de la maison familiale en Espagne par ses grands-parents qui lui a fait beaucoup de peine et le prive de tout point d’attache dans ce pays, l’obligeant désormais à s’y rendre en touriste. On peut faire l’hypothèse que l’acquisition de la nationalité espagnole serait une façon de compenser cette perte. Devenir espagnol peut ensuite être une façon de « se réconcilier » avec l’Espagne, comme pour Mario Hernandez, qui a récupéré sa nationalité d’origine il y a une dizaine d’années.
Pendant une période, on rejetait l’Espagne. On en a voulu à l’Espagne […]. On est arrivé avec la faim […]. Au point qu’on avait demandé la nationalité française […] et la vraie réconciliation, elle est toute toute récente, […] c’est quand on a demandé la double nationalité : de récupérer notre nationalité espagnole. Pour moi, personnellement, ça a été ma façon de me réconcilier avec l’Espagne, parce que malgré tout, […] c’est quand même nos origines, on a toujours un attrait, […] on veut toujours en savoir plus. […] Le rejet de l’Espagne, c’était …[…] on faisait un peu l’enterrement du retour en Espagne. C’est de dire : ce pays qui n’a pas voulu de nous, moi, à la limite, je n’en veux plus non plus […]. Et puis c’est vrai qu’on est retourné en Espagne dès qu’on a pu, surtout quand on a eu la nationalité française, […] voir la famille en vacances, etc. C’était encore le franquisme. […] Il y a la mort de Franco, l’avènement du nouveau régime en Espagne […] et moi ce qui m’a le plus réconcilié avec l’Espagne, c’est… On est allé une année chez moi et un cousin m’a dit : « Tu as vu ce qu’ils ont fait au cimetière ? » Non. Il dit : « Ils ont fait un mémorial pour les fusillés ». Je suis allé voir. Effectivement. Sur 2 murs comme ça, il y a 3000 noms de personnes fusillées jour par jour. Et le 3 juillet 1938, mon père qui y figure (Long silence). Et ça me réconcilie. Il y a eu un changement. Il n’y a pas de raison que moi je ne participe plus à ce changement. Ça m’a poussé à un moment donné à demander la double nationalité. On est électeur en Espagne.
Parmi les personnes devenues espagnoles ou qui envisagent de le devenir, la possibilité de voter en Espagne est une motivation fréquemment évoquée, alors que les descendants d’immigrés économiques, on l’a vu, ne participent pas toujours aux élections espagnoles. Les exilés et leurs descendants souhaitent prendre part à l’avenir du pays. Le vote est par exemple la première raison avancée par Victor Hernandez. La décision d’acquérir la nationalité espagnole a aussi souvent une portée symbolique familiale. Ce qui est très frappant, quand des entretiens ont été menés avec différents membres de la lignée, est que soit aucun n’évoque la question de la nationalité, soit plusieurs ou tous en parlent. Cela s’explique bien sûr par la diffusion, au sein de la famille, de l’information concernant la possibilité de devenir espagnol. Mais là n’est pas la seule raison. En général, les parents et grands-parents qui ont connaissance de cette possibilité en parlent à leurs enfants et petits-enfants et leur demandent s’ils seraient intéressés. La réponse semble fréquemment positive. Quand les parents entreprennent des voyages en Espagne dans les villages de leurs familles, ils y vont aussi souvent accompagnés de leurs enfants adolescents ou jeunes adultes. Beaucoup ont également le projet, à partir d’informations glanées auprès de leurs ascendants ou de recherches bibliographiques et archivistiques, de rédiger, pour leurs enfants, un recueil racontant l’histoire des parents ou grands-parents. À travers l’acquisition de la nationalité espagnole, il semble s’agir, symboliquement, de réenraciner la lignée en Espagne, de retisser un lien avec le passé familial espagnol, quand bien même les liens n’ont pas été coupés avec ce pays, les séjours en famille y étant fréquents et la culture espagnole valorisée. La rédaction d’un livret narrant l’histoire des ascendants semble quant à elle s’apparenter à une forme de refondation de l’héritage, comme s’il s’agissait, pour les enfants, de parvenir enfin à reconstituer l’histoire de leurs parents ou grands-parents pour pouvoir la transmettre à leurs propres enfants, tout en essayant d’alléger un petit peu le poids parfois énorme de ce passé. Ayant souffert de l’absence de transmission, les personnes concernées semblent vouloir éviter cette situation à leurs enfants, en leur proposant un récit qui, par la médiation de l’écrit, puisse peut-être mettre un peu à distance les souffrances entourant cette histoire. Dans ce contexte, acquérir la nationalité espagnole semble souvent une décision prise en partie par rapport aux enfants, comme si ce statut allait appuyer la transmission de l’héritage familial espagnol et d’une partie du passé familial. Les propos de Victor Hernandez, qui n’a pas encore d’enfants, sont à cet égard particulièrement significatifs. Outre le vote et le désir de sauvegarder la mémoire, il évoque, alors qu’il est interrogé sur les raisons pour lesquelles il a envie de prendre la nationalité espagnole, la possibilité d’une transmission :
Je sais par exemple que mon fils ou ma fille n’y échapperont pas, ça c’est sûr… Mes enfants, […] je les emmènerai en Espagne chaque année, je leur parlerai espagnol : c’est pour ça aussi que je veux être bilingue absolument. Je ne sais pas. Je ressens ce besoin de connaître un minimum l’Espagne, d’aller y passer un an ou 2 ou 3, de parler totalement espagnol et d’avoir la nationalité espagnole. […] Je pense que c’est très important pour moi en tous cas que mes enfants le sachent. C’est des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur et que j’ai envie de transmettre.
Demander la nationalité espagnole semble être aussi pour les descendants d’exilés une façon de se réinscrire dans la lignée, quand bien même cette décision, pour certains, prend le contre-pied de celle, à l’époque, de leurs parents qui leur avait fait acquérir la nationalité française. Le contexte bien sûr a changé : l’Espagne est devenue une démocratie. En outre, il ne s’agit pas, en prenant la nationalité espagnole, de perdre la nationalité française, mais d’avoir les deux nationalités. Pour autant, certains, comme Florencia Lucio, 49 ans, née en France d’un père arrivé dans l’Hexagone en 1947 à 24 ans, hésitent :
Je ne sais pas trop, parce que je suis un peu partagée avec le fait que nos parents aient décidé, quand on était enfants, de nous déclarer françaises et je me dis : après tout c’est un choix qu’ils ont fait pour nous. Aujourd’hui, revenir sur ce choix, même si on est dans un autre contexte, je ne sais pas encore … […]. Je suis un peu partagée (rires). Mais je trouve bien, en même temps, qu’il y ait une loi qui propose aux enfants et petits-enfants espagnols de pouvoir réintégrer la nationalité de leurs parents.
Florencia Lucio avait déclaré auparavant que son père, lui, « n’avait jamais voulu prendre la nationalité [française] ». Eric Fernandez, 29 ans, dont le père s’interroge sur le fait de demander ou non la nationalité espagnole, dit aussi de son grand-père qu’il n’a jamais envisagé de devenir français, comme si acquérir la nationalité espagnole était une forme de fidélité à l’héritage, alors même qu’il insiste également, comme les autres personnes rencontrées, sur l’intégration de ses grands-parents, pour lesquels, dans le contexte de l’Espagne franquiste, il n’y avait d’autres options que la France. Quant à Victor Hernandez, on l’a vu, s’il acquérait la nationalité espagnole, il prendrait la même décision que son grand-père. En raison de la forte volonté d’intégration des ascendants, soulignée par tous, du refus souvent aussi de transmettre la langue espagnole, enfin du choix de rester en France après l’avènement de la démocratie en Espagne, il ne va pas de soi que demander la nationalité espagnole soit une démarche fidèle à l’héritage, a fortiori quand les parents ou grands-parents ont acquis la nationalité française. Cette situation, d’après Geneviève Dreyfus-Armand et Florence Guilhem, n’est certes pas très fréquente, les réfugiés conservant en général leur nationalité espagnole, mais elle existe. Les naturalisations ont en revanche été nombreuses chez ceux qui sont arrivés enfants en France (53). Dans certains cas, les descendants doivent donc composer avec l’héritage de leurs ascendants pour faire de leur choix une forme de fidélité à l’héritage et se réinscrire ainsi dans la lignée. Notons enfin que, d’après la presse, certains renonceraient à acquérir la nationalité espagnole en raison du serment de fidélité au roi et à la constitution qu’ils doivent effectuer, qui revient pour eux à trahir les idéaux de leurs parents (54).
Cette rapide présentation de quelques-unes des logiques présidant à l’envie ou à la décision de demander la nationalité espagnole n’est pas, on l’a dit, exhaustive. D’autres logiques doivent exister. On peut penser par exemple qu’acquérir la nationalité espagnole peut aussi être perçu comme une façon d’obtenir la reconnaissance des parents ou grands-parents républicains ou avoir valeur de revanche.
Conclusion
On constate qu’au moment de choisir sa ou ses nationalité(s), les motivations ne sont pas les mêmes chez les descendants des exilés et des immigrés. Les descendants des immigrés économiques ont plutôt pris en compte l’aspect pratique de la nationalité, souvent choisie en fonction de celui des deux pays où ils souhaitent vivre. Chez ceux d’entre eux qui possèdent les deux nationalités, on peut observer une identification forte à l’Espagne. Les descendants des exilés politiques ont quant à eux plutôt demandé la nationalité espagnole pour des raisons symboliques, en lien avec l’histoire espagnole du XXe siècle et celle de leur propre famille. Ici, la nationalité permet, d’une certaine façon, de retrouver le passé de la famille en Espagne, mais aussi de se réconcilier avec ce pays où les exilés, désormais, ne sont plus considérés comme des vaincus.
Si les ressortissants français, descendants d’exilés, ont pu acquérir la nationalité espagnole dans le cadre de la « loi de la mémoire historique » sans que la France ne les force à renoncer à leur nationalité française, le code de la nationalité espagnole est plus restrictif pour les Espagnols acquérant la nationalité française. En permettant aux descendants des exilés d’acquérir la nationalité espagnole, les parlementaires ont souhaité, en quelque sorte, réintégrer dans la nation les familles des Espagnols qui avaient dû fuir le pays. En revanche, en limitant cette possibilité aux personnes dont un parent avait quitté le pays avant 1956, l’Espagne a écarté de ce droit et les descendants des personnes parties pour des raisons politiques entre 1956 et 1975, date de la mort de Franco, et les descendants des migrants économiques : pourtant, ces Espagnols qui ont quitté le pays à partir de 1956 ont aussi pu perdre ou dû renoncer à leur nationalité espagnole d’origine. Force est de constater qu’à ce jour, malgré l’article 11 de la Constitution espagnole, qui stipule qu’un Espagnol d’origine ne peut être privé de sa nationalité, la loi n’a toujours pas entièrement réglé la question de la perte de la nationalité pour les personnes parties d’Espagne sous le franquisme ainsi que pour leurs descendants.
1 Axes de recherches : migrations, mémoires, relations entre générations, appartenance nationale. Contact : ribert@ehess.fr
2 Axes de recherches : immigration espagnole en France, stéréotypes et représentations. Contact : tur.bruno@yahoo.fr
3 Loi 52/2007.
4 A la fin de la Guerre civile espagnole (1936-1939), quelque 500.000 personnes quittent l’Espagne en traversant les Pyrénées pour se réfugier en France. Le plus grand nombre va soit retourner en Espagne dans les mois ou années suivantes s’ils n’ont rien à craindre du régime, soit quitter la France pour s’exiler dans un autre pays, comme le Mexique, soit mourir au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale ou en déportation. Les autres vont demeurer en France et y faire souche, puisqu’ils ne pourront revenir en Espagne sans risquer d’être inquiétés par les autorités franquistes. En France, d’après les recensements de population, les Espagnols passent de 254.000 en 1936 à 302.201 en 1946. En 1951, F. Guilhem dénombre 112.266 réfugiés espagnols en France (L’obsession du retour. Les républicains espagnols, 1936-1975, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005, p. 56). En 1968, suite à l’arrivée des migrants économiques, les Espagnols forment la communauté étrangère la plus nombreuse en France : au 31 décembre, ils sont 668.060, dont 8% sont des réfugiés (F. Guilhem, ibid. p. 61). D’après le recensement de la population française de 2006, 134.000 personnes résidant en France possédaient la nationalité espagnole.
5 Nous distinguons donc les descendants des « exilés politiques » ayant quitté l’Espagne, essentiellement, pendant la Guerre civile ou le premier franquisme, des descendants des « immigrés économiques », arrivés en France – principalement à Paris et dans sa région – dans les années 1956-1974. Une première vague migratoire espagnole vers la France avait eu lieu dans l’entre-deux Guerres mondiales. Pour un aperçu général, doublé d’un état de la question, voir N. Lillo, « L’immigration espagnole en France : une histoire à approfondir », Regards, n° 14, 2010, p. 17-40.
6 Ils sont donc « espagnols d’origine », d’après le terme employé en Espagne, ce qui veut dire « espagnols de naissance ». Notons que jusqu’à la Constitution espagnole de 1978, les femmes étaient particulièrement discriminées par le droit espagnol de la nationalité. D’abord, c’est le père qui transmettait aux enfants la nationalité espagnole. Donc, un enfant de femme espagnole et de père possédant une autre nationalité, prenait la nationalité de celui-ci et ne devenait pas espagnol. Il devenait espagnol seulement si le père étranger ne le reconnaissait pas. Ensuite, si une femme espagnole épousait un étranger, elle perdait sa nationalité espagnole d’origine. La grande majorité des enfants d’immigrés nés en France a des parents tous deux espagnols. Il n’en demeure pas moins que des femmes n’ont pu transmettre à leurs enfants leur nationalité espagnole d’origine par le jus sanguinis.
7 Argentine (1969), Bolivie (1961), Chili (1958), Colombie (1980), Costa Rica (1964), Equateur (1964), Honduras (1966), Nicaragua (1961), Paraguay (1959), Perou (1959) et République Dominicaine (1968). Ces accords permettaient l’acquisition de la nationalité du pays concerné sans entraîner la perte automatique de la nationalité espagnole. http://extranjeros.empleo.gob.es/es/NormativaJurisprudencia/Internacional/ConveniosBilaterales/
8 Constitución española de 1978, art. I.11.3.
9 Les Espagnols d’origine qui prennent la nationalité de l’un des pays ayant signé un accord de double nationalité avec l’Espagne ne perdent pas leur nationalité espagnole. Ces accords règlent aussi la question des obligations militaires pour les pays n’ayant pas professionnalisé leurs armées, ou en cas de guerre. Ils définissent également la protection consulaire dont peuvent bénéficier les ressortissants lorsqu’ils ne se trouvent dans aucun des deux pays dont ils possèdent la nationalité.
10 Constitución española de 1978, art. I.11.2.
11 En matière de nationalité, le Code Civil espagnol (art. 24 et 25) distingue la perte volontaire (lorsqu’un Espagnol majeur acquiert volontairement une autre nationalité ou ne fait usage que de l’autre nationalité acquise lorsqu’il était mineur) et la perte par sanction (par une condamnation de justice ; pour avoir pris les armes ou mené des activités politiques dans un Etat étranger malgré l’interdiction du Gouvernement espagnol ; pour utilisation exclusive, pendant trois ans, d’une nationalité à laquelle on a déclaré renoncer en acquérant la nationalité espagnole. Cela ne s’applique pas aux Espagnols d’origine.) Ces cas de perte volontaire ne concernent pas les pays ayant signé un accord de double nationalité, ni ceux cités dans ce même article du Code Civil : l’Andorre, les Philippines, la Guinée Equatoriale et le Portugal.
12 A condition que la personne soit majeure et qu’elle réside à l’étranger, qu’elle acquière volontairement l’autre nationalité et qu’elle n’ait pas manifesté sa volonté de conserver sa nationalité espagnole dans les trois ans qui suivent l’acquisition de l’autre nationalité, ou dans les trois ans qui suivent la majorité si le ressortissant espagnol a acquis l’autre nationalité en étant mineur.
13 Dans le cas d’un mineur résidant habituellement à l’étranger, qui utilise exclusivement l’autre nationalité et qui n’a pas manifesté sa volonté de conserver sa nationalité espagnole dans les trois ans suivant sa majorité.
14 Ce qui est possible si la personne est majeure, réside à l’étranger et possède une autre nationalité.
15 Ce qui n’a aucun effet puisque cette déclaration ne peut entraîner la perte de la nationalité française.
16 Une minorité de réfugiés espagnols semble avoir fait le choix de la naturalisation. Voir F. Guilhem, L’Obsession du retour…, op. cit., p. 71-78.
17 Le 23 septembre 1940, Hitler, Himmler et Heydrich rencontrent Ramón Serrano Suñer, ministre de l’Intérieur de Franco. Ils décident que les Républicains espagnols déportés au camp de Mauthausen porteront le triangle bleu des apatrides, marqué d’un S pour Rot Spanier, rouge espagnol, puisque Franco a décidé de les déchoir de leur nationalité. Cependant, à Mauthausen comme dans les autres camps, tous les Espagnols n’ont pas été recensés de cette façon : à Ravensbrück, les Espagnols portaient le triangle rouge des prisonniers politiques.
18 Loi 3/2005.
19 Loi 40/2006, art. 31.
20 Loi 52/2007.
21 Notons qu’elle accorde aussi la nationalité espagnole aux volontaires des Brigades internationales sans qu’il leur soit demandé de renoncer à leur nationalité antérieure (52/2007, art. 18.1). Puisque cette précision est faite pour les Brigadistes, on comprend donc que les autres bénéficiaires, descendants d’exilés, doivent théoriquement renoncer à leur autre nationalité, ou du moins ne pas en faire un usage exclusif. Il sera donc intéressant de voir, dans quelques années, si des personnes ayant acquis la nationalité espagnole dans le cadre de cette loi ont pu la conserver.
22 Seuls les petits-enfants ont dû prouver l’exil de l’un de leurs grands-parents, avec l’un des documents suivants : un justificatif montrant que le grand-parent a perçu une pension de l’Etat espagnol en tant qu’exilé ; un justificatif émanant des Nations Unies ou de l’OFPRA ; des certificats établis par des partis politiques, des syndicats ou toute entité ou institution publique ou privée reconnue par les autorités espagnoles ou par celles du pays d’accueil, ayant un lien avec l’exil. Il fallait en outre que ce grand-parent ait quitté l’Espagne entre le 18 juillet 1936 et le 31 décembre 1955.
23 Cette date du 31 décembre 1955 pose question, car les législateurs ne l’ont pas justifiée. Elle écarte d’emblée les personnes ayant quitté l’Espagne au moment de l’émigration économique des années 60, bien que la loi 40/2006 les considère également victimes de la dictature franquiste. Par ailleurs, des personnes menacées par le régime ont continué de quitter l’Espagne après 1955, certes en moins grand nombre qu’en 1939, mais en perdant aussi leur nationalité si elles optaient pour celle du pays d’accueil. Notons que l’Institut Espagnol d’Emigration (I.E.E.) a vu le jour en 1956 : peut-être les législateurs considéraient-ils que toute émigration postérieure ne revêtait qu’un caractère économique et que plus personne, à l’étranger, n’a perdu sa nationalité espagnole d’origine ? Il s’agirait là d’une erreur. Précisons que toute personne ayant quitté l’Espagne entre ces deux dates, même pour des raisons d’émigration économique, est désormais présumée exilée.
24 Pour plus d’éléments sur la montée de ce discours, voir : E. Ribert, Liberté, égalité, carte d’identité. Les jeunes issus de l’immigration et l’appartenance nationale, Paris, La Découverte, 2006.
25 E. Ribert, « Une tendance larvée, depuis 20 ans, à une certaine «ethnicisation» de l’identité national », Journal des Anthropologues, hors série « Identités nationales d’État », 2007, p. 143-156.
26 Projet de loi n°444 portant réforme du code de la nationalité française, Assemblée nationale, 12 novembre 1986, exposé des motifs reproduit dans : Hommes et Migrations, n°1099, janvier 1987.
27 Pour plus de détails sur la genèse de cette réforme, voir P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p. 170 et s.
28 Loi n°98-170 du 16 mars 1998.
29 Article 21.7 du Code Civil.
30 Loi du 24 juillet 2006, Article 21-2 du Code Civil.
31 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.
32 Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Article 21-24 du code civil.
33 Loi du 24 juillet 2006.
34 Nous ne mentionnons ici que les conditions principales.
35 A une nuance près : lorsqu’un binational réside dans l’autre Etat dont il possède la nationalité, il ne peut y faire prévaloir sa nationalité française et y bénéficier d’une protection diplomatique française. De la même façon, cet Etat étranger ne peut apporter de protection diplomatique au binational lorsqu’il se trouve sur le territoire français.
36 Nous entendons par là les immigrés espagnols arrivés en France dans les années 1960 principalement.
37 L. Oso Casas (Dir.), K. Lurbe i Puerto, B. Tur, Transciudadanos. Hijos de la emigración española en Francia, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2007 ; E. Ribert, Liberté, égalité, carte d’identité. Les jeunes issus de l’immigration et l’appartenance nationale, Paris, La Découverte, 2006 et « La France par habitude, l’Espagne comme éventualité : regards d’enfants de migrants espagnols », Migrance, hors-série, 2007, p. 100-109.
38 Ces entretiens individuels approfondis, dont la durée moyenne était de deux heures, abordaient plusieurs points comme les études, le travail, la famille, les loisirs, la santé. Notons que la question du choix de la nationalité n’apparaissait pas spontanément.
39 Pour contacter les personnes ayant pris part à l’étude, nous avons eu recours aux associations espagnoles parisiennes, au réseau de la mission espagnole de la rue de la Pompe (Paris 16eme), à l’ambassade d’Espagne à Paris et à des contacts rencontrés au cours de recherches précédentes. La seule condition pour répondre à notre enquête était d’être descendant d’un immigré espagnol, qu’il s’agisse du père ou de la mère, ou des deux. Les parents des descendants rencontrés étaient majoritairement arrivés en France entre 1956 et 1986. L’échantillon ainsi composé ne prétend pas être représentatif de la population issue de l’immigration espagnole en France, même s’il est diversifié en ce qui concerne l’âge, le niveau d’études et la catégorie socioprofessionnelle.
40 Cette recherche a donc été financée par le Ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales et par la Fundación Francisco Largo Caballero.
41 Tous les noms cités dans cet article sont des pseudonymes.
42 Sur l’importance du retour dans l’éducation des descendants des immigrés espagnols, voir B. Tur, « Les vacances au village. Les séjours en Espagne des descendants des immigrés espagnols en France », Regards, n° 14, 2010, p. 109-123.
43 Alors qu’aucun traité de double nationalité n’existe entre les deux pays, l’Espagne et la France ont curieusement signé une convention en 1969 sur le service militaire des « doubles nationaux » ! Le binational devait effectuer le service militaire dans celui des deux pays où il résidait habituellement au cours de l’année précédant sa majorité. Ensuite, il était considéré comme ayant accompli ses obligations militaires par l’autre Etat. Voir le décret n° 70-756, paru au Journal Officiel du 25 août 1970. Par ailleurs, l’Espagne et la France ont signé la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (Strasbourg, 6 mai 1963).
44 Ces démarches s’effectuaient au consulat espagnol, où il fallait donc être inscrit. Le fait de poursuivre des études leur permettait aussi de demander leur report d’incorporation pour le service militaire français.
45 Bien sûr, s’il avait pris la nationalité française, il aurait dû accomplir son service militaire dès la fin de ses études.
46 Les Espagnols résidents fiscaux à l’étranger doivent cependant, dans le cadre d’une succession en Espagne, payer un impôt étatique (Loi 29/1987), contrairement aux résidents fiscaux en Espagne, soumis à un impôt autonomique que la plupart des Communautés autonomes ont d’ailleurs supprimé.
47 L’Espagnol résidant à l’étranger doit au préalable obtenir une attestation de domicile consulaire pour demander le DNI en Espagne.
48 Quotidien d’information sportive.
49 J.-L. Richard, Partir ou rester ? Destinées des jeunes issus de l’immigration, Paris, PUF, 2004.
50 Censo Especial de Residentes Ausentes en el Extranjero.
51 Sur le statut des exilés, voir A. Angoustures, « L’exil espagnol et le statut de réfugié », in Les réfugiés en France et en Europe. Quarante ans d’application de la Convention de Genève, 1952-1992, Paris, OFPRA, 1992, p. 187-207.
52 Quand l’un des parents était combattant et l’autre enfant pendant la Guerre civile, la personne rencontrée a été classée comme d’au moins un parent combattant. Le même principe s’applique aux petits-enfants.
53 G. Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France, de la Guerre civile à la mort de Franco, Paris, Albin Michel, 1999, p. 299, 334 et s. ; F. Guilhem, L’Obsession du retour…, op. cit., p. 71-78.
54 « Les enfants d’exilés de la guerre civile veulent devenir espagnols », La Croix, 14/01/2009. http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Les-enfants-d-exiles-de-la-guerre-civile-veulent-devenir-espagnols-_NG_-2009-01-15-529958
BIBLIOGRAPHIE
xxANGOUSTURES, Aline, « L’exil espagnol et le statut de réfugié », in Les réfugiés en France
et en Europe. Quarante ans d’application de la Convention de Genève, 1952-1992, Paris,
OFPRA, 1992, p. 187-207.
xxDREYFUS-ARMAND, Geneviève, L’exil des républicains espagnols en France, de la Guerre
civile à la mort de Franco, Paris, Albin Michel, 1999, 475 p.
xxGUILHEM, Florence, L’obsession du retour. Les républicains espagnols, 1936-1975, Toulouse,
Presses universitaires du Mirail, 2005, 220 p.
xxLILLO, Natacha, « L’immigration espagnole en France : une histoire à approfondir », Regards,
n° 14, 2010, p. 17-40.
xxOSO CASAS, Laura (Dir.), LURBE I PUERTO, Kàtia, TUR, Bruno, Transciudadanos. Hijos de
la emigración española en Francia, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2007.
xxRIBERT, Evelyne, « La France par habitude, l’Espagne comme éventualité : regards d’enfants
de migrants espagnols », Migrance, hors-série, 2007, p. 100-109.
xx——————, Liberté, égalité, carte d’identité. Les jeunes issus de l’immigration et l’appartenance
nationale, Paris, La Découverte, 2006, 273 p.
xx——————, « Une tendance larvée, depuis 20 ans, à une certaine «ethnicisation» de l’identité
nationale », Journal des Anthropologues, hors série «Identités nationales d’État», 2007,
- 143-156.
xxRICHARD, Jean-Luc, Partir ou rester? Destinées des jeunes issus de l’immigration, Paris,
PUF, 2004, 258 p.
xxTUR, Bruno, « Les vacances au village. Les séjours en Espagne des descendants des immigrés
espagnols en France », Regards, n° 14, 2010, p. 109-123.
xxWEIL, Patrick, Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la
Révolution, Paris, Grasset, 2002, 651 p.
Pandorra 10.indd 41 31/05/13 14:41